Facteurs qui ont rendu l’Occident plus prospère que l’Afrique : Les Indicateurs de prospérité
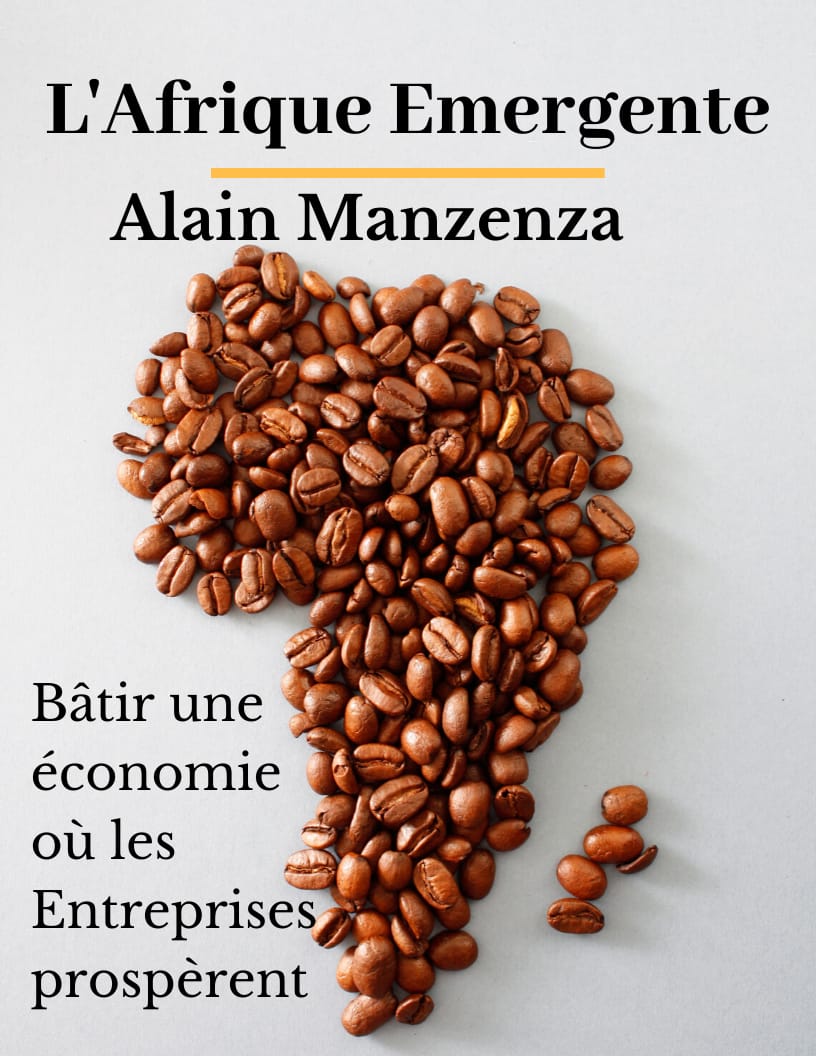
Tiré du livre « L’Afrique émergente, bâtir une économie où les entreprises prospèrent » Alain Manzenza
Aucun économiste n’a jamais prétendu qu’il existe une seule force motrice derrière la croissance économique. Qu’est-ce qui permet à l’occident d’être tellement prospère que l’Afrique ? Plusieurs avis sont suggérés.
Meilleur équipement de travail
Dans les pays prospères, les gens ont un meilleur équipement pour travailler (les perceuses électriques sont plus puissantes que les pioches ; les tracteurs sont supérieurs aux charrues ; et la médecine moderne est beaucoup plus efficace que les cures traditionnelles, par exemple). Ainsi, un argument veut que l’accumulation de capital physique (plus précisément, le capital manufacturé) dans le monde prospère a contribué de manière significative au niveau de vie élevé dont jouissent les gens.
Main-d’œuvre qualifiée
D’autres ont noté que les habitants des pays riches sont bien mieux éduqués, ce qui implique qu’ils peuvent utiliser des idées pour produire des biens hors de portée des habitants des pays où un grand nombre est analphabète. La proportion d’adultes (personnes âgées de 15 ans et plus) alphabétisés dépasse aujourd’hui 95% dans le monde riche, mais seulement 58% dans le monde pauvre (World bank, 2005). Les inégalités entre les sexes sont considérablement plus importantes dans les pays pauvres que dans le monde riche. La proportion de femmes adultes alphabétisées dans les pays pauvres est de 48%, alors que dans le monde riche, la proportion correspondante est à peu près la même que celle des hommes, à savoir plus de 95% (World bank, 2005).
La santé
L’espérance de vie à la naissance dans les pays riches est désormais de 78 ans, alors qu’elle est d’environ 58 ans dans les pays pauvres. Quelques 120 enfants sur 1 000 de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde pauvre ; le chiffre correspondant pour les pays riches est de 7. De même, l’eau propre et une bonne hygiène ont considérablement réduit la morbidité dans les pays riches. Environ un quart de la population du monde pauvre souffre de sous-alimentation, alors que le chiffre correspondant dans les pays riches est négligeable.
Comme la malnutrition et la vulnérabilité aux infections se renforcent mutuellement, la mauvaise alimentation et la morbidité vont de pair. Il existe des preuves que la sous-alimentation dans la petite enfance affecte le développement des facultés cognitives. Dans l’ensemble, la personne moyenne dans le monde riche est capable de fournir un travail de meilleure qualité et pendant de nombreuses années de plus que son homologue dans un pays pauvre.
Le capital humain
L’éducation et la santé portent le nom de capital humain. Une littérature lancée par les économistes Theodore Schultz et Gary Becker révèle que l’accumulation de capital humain a été un facteur important à l’origine du niveau de vie élevé dans le monde développé aujourd’hui. Cependant, de nombreux économistes considèrent la production de nouvelles idées comme le principal facteur du progrès économique.
Ils disent que les pays riches sont devenus riches parce que les gens ont réussi à produire des idées non seulement pour de nouveaux produits (presse à imprimer, machine à vapeur, électricité, produits chimiques, ordinateur électronique), mais aussi pour des façons moins chères de fabriquer des produits anciens (transport, exploitation minière). Bien sûr, l’éducation et les progrès de la science et de la technologie se combinent en tant que force économique.
La production des idées
L’enseignement primaire et secondaire à lui seul ne peut pas mener une société aussi loin aujourd’hui. Un pays où l’enseignement supérieur est faible n’aurait pas une population capable de travailler avec les technologies les plus avancées. Les avancées scientifiques et technologiques ne peuvent pas non plus être réalisées aujourd’hui par des personnes sans formation avancée.
Facteurs démographiques
Depuis le milieu des années 60, la population de ce qui est aujourd’hui le monde pauvre a augmenté à un taux annuel moyen d’environ 2,4%, tandis que le chiffre correspondant dans le monde riche d’aujourd’hui était d’environ 0,8%. C’est une grande différence. Les démographes statistiques conviennent désormais que, en tenant compte d’autres facteurs, les pays où la croissance démographique a été importante au cours des dernières décennies ont connu une croissance lente du PIB réel par habitant. La forte croissance démographique dans les pays pauvres d’aujourd’hui a également exercé une pression énorme sur leur écologie, créant de nouveaux problèmes pour les populations rurales. La croissance démographique d’un pays est affectée non seulement par la reproduction nette, mais aussi par l’immigration nette et la répartition par âge. Afin d’isoler la reproduction nette, il est courant de travailler avec le taux de fécondité (plus précisément, le taux de fécondité total), qui est le nombre de naissances vivantes qu’une femme prévoit d’accoucher au cours de sa vie.
Tous les économistes semblent convenir que l’accumulation de capital manufacturé, de capital humain et la production, la diffusion et l’utilisation de nouvelles idées scientifiques et technologiques vont de pair, chacune contribuant positivement au développement économique.
Dans le monde contemporain, une accumulation, disons, de biens d’équipement manufacturés augmente le PIB réel. Cela permet aux sociétés de consacrer davantage de leurs revenus à l’éducation et à la santé, ce qui entraîne une baisse de la fécondité et de la mortalité infantile. L’éducation augmente encore le PIB, tandis que la baisse de la fécondité et de la mortalité infantile ralentit généralement la croissance démographique ; qui, pris ensemble, permettent aux sociétés de consacrer davantage de leurs revenus à la production de nouvelles idées. Cela augmente la productivité du capital manufacturé ; ce qui entraîne à son tour une nouvelle accumulation de capital manufacturé ; et ainsi de suite, dans un cercle vertueux de prospérité ou bien sûr, un cercle vicieux de pauvreté.
Le progrès technologique
Comment la croissance se produit-elle ? Elle survient lorsque les gens acquièrent des connaissances et les utilisent, ou lorsque les gens utilisent mieux ce qu’ils savent déjà. C’est pourquoi les économistes le qualifient souvent la croissance de la productivité totale des facteurs de progrès technologique. Mais il y a d’autres changements dans une économie qui peuvent encourager le développement, comme l’amélioration du fonctionnement des institutions.
La croissance de la productivité totale des facteurs de progrès technologique n’est peut-être pas un bon moyen de transmettre une idée, mais elle reflète assez bien la part inexpliquée de la croissance du PIB réel. Depuis la Seconde Guerre mondiale, La croissance de la productivité totale des facteurs de progrès technologique dans le monde riche a été considérable. Il a été estimé, par exemple, qu’au cours de la période 1970-2000, le taux de croissance annuel moyen de la productivité totale des facteurs de progrès technologique au Royaume-Uni était de 0,7%. Les économistes ont estimé qu’en revanche, La croissance de la productivité totale des facteurs de progrès technologique a légèrement diminué dans un certain nombre de pays d’Afrique subsaharienne au cours de la même période. Que veulent dire ces chiffres ? Prenons le cas du Royaume-Uni. Le PIB réel du pays a augmenté à un taux annuel moyen de 2,4%, ce qui signifie qu’environ 29% de cette croissance (soit 0,7 / 2,4) pourraient être attribués à une augmentation de la croissance de la productivité totale des facteurs de progrès technologique. Avec un taux de croissance de 2,4%, le PIB réel en 2000 était le double du PIB réel en 1970. Près d’un tiers de cette augmentation peut être attribué à la croissance de la productivité totale des facteurs de progrès technologique.
En revanche, les économies de l’Afrique subsaharienne où la productivité totale des facteurs de progrès technologique a baissé au cours de cette période sont devenues moins efficaces dans leur utilisation de facteurs de production tels que les machines et l’équipement, les compétences et les heures de travail. Il est difficile de croire que les habitants de ces pays ont systématiquement oublié les connaissances techniques qu’ils connaissaient dans le passé. La baisse de la productivité totale des facteurs de progrès technologique doit donc être due à une détérioration des institutions locales, précipitée par les guerres civiles et la mauvaise gouvernance. Les pays pauvres d’aujourd’hui se trouvent principalement sous les tropiques, tandis que les pays riches se trouvent principalement dans les zones tempérées. Les tropiques sont sans aucun doute un terreau fertile pour de nombreuses maladies, mais elles abritent également de grandes quantités de ressources naturelles (bois, minéraux et conditions propices à la production d’épices, de fibres, de café et de thé).
Au cours des derniers siècles, les pays riches d’aujourd’hui ont importé ces mêmes ressources et produits pour alimenter leurs usines et moulins et pour rendre leurs repas agréables. Ils accumulaient des machines, du capital humain et produisaient également des connaissances scientifiques et technologiques.
Pourquoi les pays pauvres n’ont-t-il pas profité de ces ressources pour s’enrichir de la même manière ?
La colonisation est une réponse possible. Les historiens ont montré que, à partir du XVIe siècle, les puissances européennes ont extrait les ressources naturelles des colonies – y compris la main-d’œuvre bon marché (esclave) – mais ont surtout investi les bénéfices au niveau national. Bien sûr, il faut se demander pourquoi les Européens ont réussi à coloniser les tropiques (l’Afrique) ; pourquoi la colonisation n’a pas eu lieu dans l’autre sens. Comme indiqué précédemment, Jared Diamond a proposé une réponse. Cela dit, bon nombre des plus éminentes de ces ex-colonies sont politiquement indépendantes depuis des décennies. Pendant cette période, le revenu réel par habitant dans le monde riche n’a cessé d’augmenter. À l’exception de quelques exemples frappants en Asie du Sud et du Sud-Est, cependant, la plupart des ex-colonies sont restées pauvres ou sont devenues encore plus pauvres. Pourquoi ?
Les Institutions
Les historiens de l’économie tels que Robert Fogel, David Landes et Douglass North ont soutenu que le monde riche est riche aujourd’hui car, au fil des siècles, il a conçu des institutions qui ont permis aux gens d’améliorer leurs conditions matérielles de vie. Ceci est une explication plus profonde. Il dit que les gens dans les pays riches travaillent avec des technologies supérieures, sont en meilleure santé, vivent plus longtemps, sont mieux éduqués et produisent de nombreuses idées plus productives, car ils ont pu continuer leur vie dans des sociétés dont les institutions permettent – voire encouragent – l’accumulation à l’échelle de l’économie de facteurs de production tels que les machines, les moyens de transport, la santé, les compétences, les idées et les fruits de ces idées.
L’accumulation d’actifs productifs en capital n’est qu’une cause immédiate de prospérité, la véritable cause étant les institutions progressistes. Comment et pourquoi les anciens des pays riches d’aujourd’hui ont pu façonner leurs institutions de manière à faire exploser ces causes immédiates de prospérité. On peut même se demander si les institutions l’ont fait ou si ce sont les politiques éclairées des dirigeants qui ont été responsables de l’explosion. Mais ensuite, les politiques ne sont pas arrachées de l’air, elles émergent des consultations et des délibérations au sein des institutions. Il n’est pas non plus probable qu’une politique conçue pour apporter la prospérité à un pays ne fonctionnera réellement que si les institutions là-bas sont capables de la mettre en œuvre.
Ces dilemmes sont d’une importance capitale pour les pays pauvres d’aujourd’hui. Quelles institutions devraient-ils adopter et quelles politiques leurs gouvernements devraient-ils être encouragés à suivre? Il est inutile de se lancer dans des projets grandioses (aciéries, usines pétrochimiques, réforme agraire, programmes de santé publique, éducation gratuite) à moins que les institutions d’un pays ne disposent des freins et contrepoids nécessaires pour limiter la corruption et le gaspillage. Cela nous ramène à notre question précédente : comment les institutions qui ont favorisé la croissance économique dans les pays riches d’aujourd’hui se sont-elles établies et se sont-elles développées? Malgré l’attention que la question a suscitée de la part des historiens économiques les plus éminents du monde, la question n’est toujours pas réglée.
Compte tenu des difficultés, il est plus sûr de considérer les institutions comme le facteur explicatif lorsque nous cherchons à comprendre pourquoi les mondes développé et sous développé diffèrent tellement en termes de niveau de vie. L’Oxford English Dictionary définit l’institution comme « une loi, une coutume, un usage, une pratique, une organisation ou tout autre élément établis dans la vie politique ou sociale d’un peuple».
Par institutions, j’entends, très approximativement, les dispositions qui régissent les entreprises collectives. Ces accords incluent non seulement des personnes morales, les marchés mais aussi les réseaux ruraux. Et ils incluent cette entité globale appelée gouvernement. Les institutions sont définies en partie par les règles et la structure d’autorité qui régissent les entreprises collectives, mais aussi en partie par les relations qu’elles entretiennent avec les étrangers.
Par exemple, les pays riches ont des lois relatives aux conditions de travail dans les usines. De plus, les réglementations environnementales limitent ce que les entreprises peuvent faire avec leurs employés. Dans chaque société, il existe des couches de règles de couverture variée. Certaines règles relèvent d’autres règles, beaucoup ont force de loi, tandis que d’autres sont au mieux des accords tacites. L’efficacité d’une institution dépend des règles qui la régissent et du respect de ses membres. Les codes de conduite dans la fonction publique de chaque pays incluent l’honnêteté, mais les gouvernements diffèrent énormément quant à sa pratique. Les spécialistes des sciences sociales ont construit des indices de corruption parmi les fonctionnaires. Un de ces indices est basé sur la perception que les entreprises privées ont acquise, sur la base de leur expérience, des pots-de-vin que les gens ont dû payer aux fonctionnaires pour faire des affaires.
L’indice – sur une échelle de 1 (très corrompu) à 10 (très propre) – est inférieur à 3,5 pour la plupart des pays pauvres (les pays africains et l’Europe de l’Est sont parmi les pires) et supérieur à 7 pour les pays les plus riches (les pays scandinaves sont parmi les meilleurs). Il a été soutenu que la corruption d’agents publics contribue à augmenter le revenu national car elle lubrifie les transactions économiques. Il le fait dans un monde corrompu : si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas faire des affaires.
Mais la corruption n’est pas un mal inévitable. Il existe plusieurs pays pauvres où la corruption est faible. Le fait de payer des pots-de-vin augmente les coûts de production ; donc moins est produit. Les citoyens souffrent, car le prix qu’ils doivent payer pour les produits est beaucoup plus élevé. Les économistes ont émis l’hypothèse que la corruption du gouvernement est liée aux retards auxquels les gens sont confrontés pour faire respecter l’état de droit.
L’idée est que les retards sont un moyen d’obtenir des pots-de-vin pour accélérer les procédures judiciaires. L’exécution d’un contrat prend 415 jours dans le monde pauvre, contre 280 jours dans le monde riche. Il se peut que la corruption soit également liée à l’inefficacité du gouvernement. L’enregistrement d’une entreprise prend 66 jours dans le monde pauvre, 27 jours dans le monde riche. Dans les pays pauvres, l’enregistrement d’une propriété prend en moyenne 100 jours, tandis que dans les pays riches, le chiffre est de 50 jours.
Certains économistes ont suggéré que les responsables gouvernementaux des pays pauvres créent de longues files d’attente (c’est l’inefficacité du gouvernement) afin d’obtenir des pots-de-vin des candidats s’ils veulent sauter ces files d’attente (c’est de la corruption). Comment la corruption, l’inefficacité et l’indifférence du gouvernement à l’égard de l’État de droit se traduisent-elles par le type de statistiques macroéconomiques que nous avons étudiées ici ? Ils laissent leur empreinte sur la productivité totale des facteurs de productivité. Toutes choses étant égales par ailleurs, un pays dont le gouvernement est corrompu ou inefficace, ou où l’état de droit n’est pas respecté, est un pays dont la productivité totale des facteurs de production est inférieure à celle d’un pays dont le gouvernement souffre de moins de ces défauts. Certains chercheurs appellent ces facteurs des facteurs sociaux intangibles mais quantifiables, d’autres le capital social. Les institutions sont des entités primordiales. Les gens interagissent entre eux dans les institutions. Une notion plus fondamentale est celle des engagements entre les gens. La possibilité d’engagements pose un problème fondamental de la vie économique.
Le prochain article dans cette série « Deux enfants, naissant dans deux différents mondes économiques ont deux futurs différents, pourquoi? ».
Alain Manzenza est l’un des meilleurs penseurs de notre temps avec les formations les plus puissantes en classe ou en format à la demande; Il est Auteur de l’Afrique Emergente. Il est aussi le directeur de Développement International de AMM Research Global Institute of Management et le CEO de Manzenza Global Inc. www.manzenzaglobal.com E: info@manzenzaglobal.com, support@manzenzaglobal.com
T: +44 (0) 7308674758




